Extrait du blog d’Emmanuel Tugny sur Médiapart
Emmanuel Tugny : Être un lecteur compulsif ne signifie pas nécessairement être un écrivain.
Comment se produit chez vous ce « passage éthique » ?
Gilberto Schwartsmann : Je lis beaucoup depuis l’enfance, et ma famille m’a toujours suggéré la lecture des bons auteurs.
J’écris pour moi, par nécessité personnelle.
Je n’écris pas pour les lecteurs.
ET : Quand vous dites que vous « n’écrivez pas pour les lecteurs », vous posez un paradoxe : la question de la publication engage le postulat d’une relation à la réception…
Comment écrire pour soi et entrer dans le jeu éditorial ?
GS : J’ai beaucoup écrit pour des journaux, sur les défis de la vie quotidienne, sur l’art, sur la culture, sur les valeurs humaines, sur la politique, sur mon pays, le Brésil, sur le racisme, sur les injustices sociales, mais ces dernières années, j’ai décidé d’écrire des essais plus longs et des romans.
Je ne connais pas encore le « jeu éditorial », mais il ne doit pas être très différent des autres jeux de l’existence…
J’ai l’espoir que quelqu’un puisse s’identifier à ma manière d’écrire : J’en serais heureux, et j’aurais l’impression d’avoir accompli ma tâche.
Néanmoins, ce n’est pas la condition sine qua non de la poursuite de ma tentative littéraire.
J’espère qu’un jour, quelqu’un trouvera sur une île déserte la bouteille qui contient mes livres…
Mais une fois de plus, ce n’est pas la condition de la poursuite de mon travail.
ET : Disons qu’au champ littéraire, la question esthétique prévaut…
Cela revient à dire, que la méthode d’écriture tend à chercher un usage du langage qui entre en résonance avec la sensibilité du lecteur…
Par conséquent, publier de la littérature suppose une conception préalable de cette sensibilité, fût-elle instinctive…
Je repose donc ma question différemment : si vous écrivez pour vous, pour quelle « part de vous » écrivez-vous ?
GS : Je me suis toujours intéressé à la beauté des choses, qu’elles fussent de la nature, de la culture ou de l’art.
Elle m’a toujours ému.
La générosité des gens m’émeut. Mais je souffre devant les injustices et la méchanceté.
C’est pourquoi je préfère toujours les auteurs qui créent des textes esthétiquement riches et moralement élevés. J’essaie de les imiter en bondant mes textes de belles images.
Je sens en moi beaucoup de fragilité, je souffre des douleurs du monde.
En ce sens, la littérature m’aide, elle fonctionne comme un remède.
ET: On peut donc dire que c’est en tant que « part de l’humanité », que vous vous considérez votre premier lecteur ?
Comment s’aborde cette question de l’auteur, comme métonymie du lecteur ?
N’est-ce pas là la morale du Parent d’Humanité ?
GS : Cela se peut. Je me considère comme mon premier lecteur. Il semble que j’aie besoin d’un miroir moral et esthétique. Je veux voir le résultat de cette expérience.
Le Parent d’Humanité répond à mon désir de faire partie du groupe des êtres humains que j’admire, d’intégrer un « autre monde » …
J’ai trouvé très amusant de m’imaginer parent d’hommes illustres, bons ou mauvais, afin de ne pas oublier que je suis humain.
ET : Comment être auteur, c’est-à-dire quasi démiurge, et en même temps admirer la mêmeté de l’autre ou s’y voir ? N’y a-t-il pas une contradiction entre création de monde et sentiment de mêmeté ?
GS : Je ne me vois pas comme une divinité qui cherche à remodeler le monde. Je voudrais que les lecteurs reconnussent, peut-être, un effort individuel de chercher un sens littéraire, un texte agréable et en même temps beau et générateur de réflexion. Mais tout se fonde sur une catharsis, sur l’expulsion de quelque chose que je n’ai que partiellement digéré. C’est peut-être vanité de ma part, mais je pense que des gens qui me ressemblent aimeront mes livres et leur pardonneront leur excès d’information. C’est ma façon. J’aimerais pouvoir parvenir à une forme textuelle qui ne fût pas triviale, prévisible ou redondante ; qui m’émeuve, et, mieux encore, qui émeuve le lecteur.
ET : J’en reviens au contenu du Parent d’Humanité : à partir de quel point tendez-vous à considérer que l’équilibre d’un chapitre est atteint ?
GS : Je voudrais que les chapitres pussent survivre en tant que textes indépendants. Parfois, je relis certains mouvements, et ils m’émeuvent. Mais je l’avoue : mon texte progresse bien vers son finale, qui est une déclaration d’amour à l’humanité.
ET : Le Parent d’Humanité me semble très lié à la conception talmudique de « l’être au monde » : quelle est l’influence du judaïsme de l’errance sur votre œuvre ?
GS : Je m’impose toujours une recherche d’universalité. Je descends d’une famille juive qui a fui l’antisémitisme. Cependant, je ne me veux le sectateur d’aucune religion. Je ne mise que sur les valeurs humaines universelles. J’ai voulu éviter à mes enfants toutes les formes de cantonnement. Je ne crois qu’aux valeurs qui rapprochent et je hais les idéologies. Oui, je ne crois qu’en la beauté qui rapproche.
ET : Ce lecteur dont vous faites un « même », comment le convaincre de la nécessité de rencontrer un auteur ?
GS : Je ne vois rien d’unique en moi. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi, visent la préservation des hautes valeurs. Je lutte contre l’emprise du banal. A mes yeux, la beauté est l’outil de cette conjuration.
ET : Dans le contexte français, la plasticité avec laquelle vous passez de la leçon à la fiction peut surprendre. Existe-t-il selon vous une littérature ontologiquement brésilienne ?
GS : Je pense que non. Il n’y a pas d’ontologie nationale. Les circonstances historiques ou géographiques n’influent en rien sur les choix esthétiques et moraux.
ET : Certes mais y a-t-il pour vous une littérature brésilienne ?
GS : Je ne crois qu’en une littérature universelle.
ET : Finalement, le lecteur du Parent d’Humanité peut considérer qu’Akounine (peut-être comme le Vautrin de Balzac) est le protagoniste du roman : partagez-vous ce point de vue ?
GS : Pas seulement lui : Mélina ou moi-même aussi. Nous visons tous à définir l’Humain. Les démons qui nous habitent sont toujours profondément attrayants : ils nous rappellent notre humanité.
ET : L’Histoire des formes et des idées a mis sur pied d’innombrables définitions esthétiques ou morales de la « bonne littérature » : en peu de mots, quelle est la vôtre ?
GS : La bonne littérature est celle qui porte en elle tout à la fois beauté et vérité : c’est en tout cas ce que je vois dans les grandes œuvres que je connais…


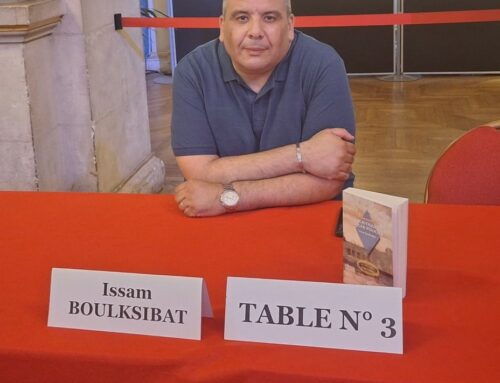


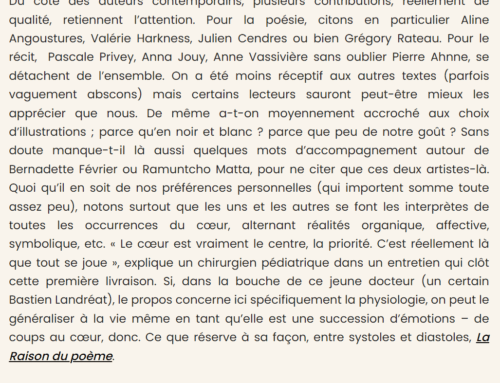
Laisser un commentaire